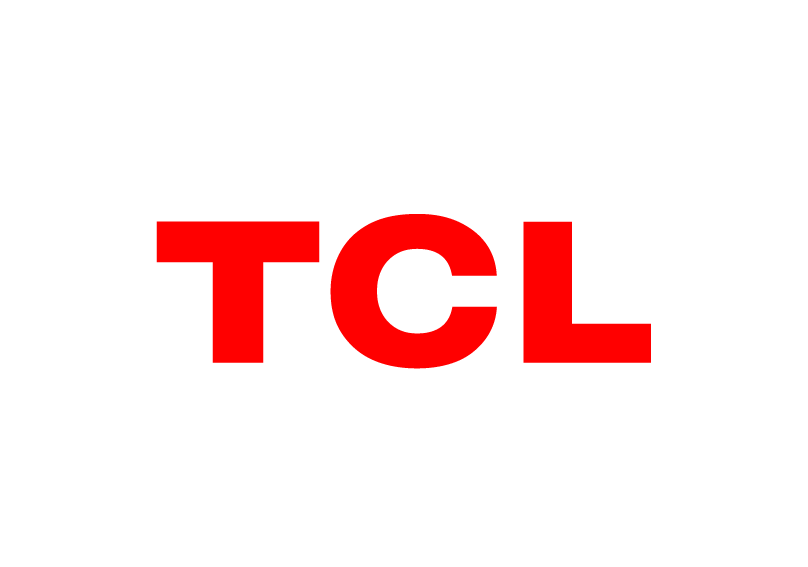Le sang bleu
35 min
 6 min
6 min
Casting
Ils ont toutes et tous porté un maillot, une combinaison ou une veste de l’équipe de France. Christine Caron, Marie Bochet, Perrine Laffont, Sandrine Martinet, Jackson Richardson, Alexis Hanquinquant et Tony Parker racontent ce qu’est exactement “avoir le sang Bleu”.
Par ordre alphabétique
Marie Bochet (para ski alpin)
Octuple championne paralympique, 20 titres de championne du monde, assez solide en matière de Marseillaise. “Sur le tempo tout du moins.”
Christine Caron (natation)
Dite “Kiki”, reine des bassins européens dans les années 1960, vice-championne olympique du 100 mètres dos à Tokyo (1964), ex-détentrice de records d’Europe et du monde, championne des États-Unis en 1965 même ! A “partagé un saucisson avec Jacques Chirac, eh ouais !” dit-elle.
Alexis Hanquinquant (para triathlon)
Champion d’Europe et du monde, catégorie PTS 4 (handicaps dits modérés) 2017, 2018, 2019, champion de France 2017, 2018, 2019, 2020, détenteur d’une belle théorie sur les Normands.
Perrine Laffont (ski de bosses)
Championne olympique en titre, championne du monde en titre, reine du circuit Coupe du monde depuis quatre saisons et elle n’a pas encore un quart de siècle.
Sandrine Martinet-Aurières (para judo, catégorie malvoyants)
Championne paralympique 2016 des moins de 52 kg, 3 fois championne du monde, 12 fois championne de France, sait aller au bout d’une demi-finale paralympique malgré une malléole cassée.
Tony Parker (basket)
Quatre bagues NBA aux doigts (2003, 2005, 2007 et 2014), a testé tous les métaux possibles aux Euros de basket (bronze en 2005, argent en 2011 et or en 2013), 181 sélections en équipe de France, son numéro, le 9, retiré des Spurs de San Antonio. Venez le chercher !
Jackson Richardson (handball)
Barjot couvert de bronze aux JO 1992, deux titres de champion du monde (1995 et 2001), meilleur joueur du monde en 1995, porte-drapeau de la délégation olympique en 2004, a déjà discuté pétanque avec Charles Barkley. Lui aussi, venez-le chercher !
Des Bleus dans les yeux
JACKSON RICHARDSON : Quand j’étais petit, avec les trois heures de décalage horaire entre La Réunion et la métropole, le sport était rare à la télé. Ma première image, c’est l’équipe de France de foot au Mondial 1982 : Séville, Schumacher, Battiston... On se retrouvait à une trentaine de potes, autour d’un repas à la MJC (la Maison des jeunes et de la culture), un lieu magique, et on suivait les matchs. C’est le foot qui m’a fait rêver de porter un jour ce maillot bleu... ou blanc.
“Le plus important, c’est de participer…” J’ai toujours eu du mal avec ça
TONY PARKER : Moi aussi. En 1998, je suis à l’Euro juniors en Hongrie avec l’équipe de France de basket quand je vois les Bleus gagner la Coupe du monde et toutes les couleurs de peau être aussi heureuses. Cette équipe de foot a dégagé une force incroyable sur la population. Avant, on entendait trop la phrase de Coubertin : “Le plus important, c’est de participer…” J’ai toujours eu du mal avec ça. Mon père, un Américain, m’a inculqué la culture de la gagne. France 1998 correspondait à ma vision du sport. Teddy Riner a aussi fait partie de cette génération d’athlètes français qui, à ce moment-là, se sont dit : “Oui, nous aussi, on peut gagner...”
CHRISTINE CARON : Madame Suzanne Berlioux m’a repérée dans une piscine parisienne. Elle a aimé, dit-elle, ma façon d’être dans l’eau, de flotter. Il y a eu une attirance inexplicable entre nous, et je suis arrivée au Racing Club de France, à 8 ans, un peu par ce hasard-là. À l’époque, ce très grand club avait une notoriété mondiale, un très haut niveau de compétition. Mon entraîneur, Madame Berlioux, entraînait aussi les nageuses de l’équipe de France. Donc j’ai très vite baigné avec ce lien fort.
Keystone/Hulton Archive/Getty Images)
Premières idoles
MARIE BOCHET : Enfant, quand je croisais les athlètes avec la veste de l’équipe de France de ski, je voyais des demi-dieux, avec leur costume de super-héros sportif. Clairement, voir Julien Lizeroux ou Jean-Baptiste Grange avec la veste des Bleus ou en civil, ça ne me faisait pas la même chose. Et un jour, lors d’un entraînement, je monte dans une télécabine. Jean-Baptiste et Julien y sont aussi. J’ai super froid aux pieds et je me rends compte qu’eux aussi. Comme moi. Ça désacralise le truc quand même. Des années plus tard, quand je commençais à avoir des résultats, j’étais à la même table qu’eux, de Tessa Worley aussi, pour une séance de dédicaces. Voilà, moi, la petite qui les regardait avec de grands yeux : j’étais là, avec eux.
CHRISTINE CARON : Je n’ai jamais eu d’idoles, à vrai dire. Mais à mes débuts en natation, je me souviens très bien de Rose-Marie Piacentini, qui faisait du dos, comme moi, et était entraînée par Madame Berlioux, comme moi. En 1961, elle détenait le record d’Europe du 200 mètres. Je me suis tout de suite dit que je devais commencer par la battre, elle. C’est arrivé en 1963.
PERRINE LAFFONT : Petite, j’avais deux idoles, au point d’imprimer leurs photos pour les afficher dans ma chambre : Guilbaut Colas et Hannah Kearney, une Américaine championne olympique en 2010, qui gagnait tout à cette période-là. Guilbaut avait un run parfait, un style de virage trop beau, comme s’il survolait le champ de bosses. Le ski a cet avantage que tu peux être facilement au contact des stars. Donc j’ai pu échanger avec eux. Quand je débute en Coupe du monde, en 2014, Guilbault terminait sa carrière et m’a un peu prise sous son aile. Au début, je n’osais pas trop lui parler. Et finalement, on est devenus potes.
SANDRINE MARTINET : Je me souviens particulièrement de Catherine Fleury, en judo, sur les J.O de Barcelone. Au-delà de sa victoire, elle m’avait marquée à l’époque par sa détermination, sa rage de vaincre. Je me disais : “Quelle nénette !” Elle ne lâchait vraiment rien. Plus tard, Lucie Décosse m’a aussi énormément inspirée.
Le déclic du bataillon de Joinville
Coqs au vent
CHRISTINE CARON : La date exacte, je ne sais plus, mais c’était bien avant les J.O de Tokyo 1964. Il y avait bien moins de courses qu’aujourd’hui, les championnats du monde n’existaient pas, donc on faisait des France-Belgique, France-Allemagne. Et ma première sous les couleurs de l’équipe de France, c’était à Sonthofen, en Bavière, dans un truc militaire. Je devais avoir 12 ans. J’étais hyper contente et fière de représenter mon pays. Et puis le monde s’ouvrait, c’étaient les Trente Glorieuses, j’allais sur un chemin qui me branchait beaucoup. Je l’ai su très jeune, ça. À 12 ans, j’avais déjà fait les minima olympiques pour Rome (1960). Mais on n’emmenait pas les gamines de cet âge-là aux Jeux, à l’époque. Donc j’ai attendu et fait les Jeux de Tokyo, en 1964.
TONY PARKER : Je débute à 14 ans avec l’équipe de France cadets pour l’Euro en Belgique. J’étais tellement surpris que je n’avais même pas le passeport français, alors que j’y vivais depuis ma naissance. Mon père a dû aller faire les papiers en vitesse. J’étais trop content. Avec ma famille, on n’allait jamais en vacances, donc là, j’ai découvert la vie, une autre vie, mes premiers voyages. Dès cette première compétition, une flamme est née dans mon cœur pour l’équipe de France, la fierté de porter ce maillot.
ALEXIS HANQUINQUANT : Moi, je commence en mars 2017, à Gold Coast, en Australie. En plein entraînement, je m’arrête au milieu de la piscine. Je percute que, pour la première fois de ma vie, je vais représenter mon pays. J’en ai la chair de poule, parce que c’est mon rêve. Et je remporte trois jours plus tard cette course, qualificative pour les championnats d’Europe.
La théorie normande
Par Alexis Hanquinquant
Pourquoi le coq ?
Sandrine Martinet, Christine Caron, Jackson RIchardson
JACKSON RICHARDSON : T’as la sensation d’entrer dans la cour des grands. Je me souviens toujours de ce que nous a dit Daniel Costantini (le sélectionneur) à mon premier regroupement : “Vous êtes des jeunes, vous n’avez rien à prouver, au contraire, prenez un maximum de plaisir d’être là aujourd’hui, vous avez l’avenir devant vous.” Dans les années 1990, le handball était encore un sport amateur. Je jouais à Paris-Asnières, devant 1000 personnes max à chaque match. Là, avec la France, c’était une salle de 3000 à 5000 personnes. La présentation, l’entrée dans le gymnase, l’hymne, tout ce protocole… C’était fabuleux.
PERRINE LAFFONT : Dix mois avant les JO de Sotchi, je peux prétendre à une place. Donc je m’entraîne comme une folle, avec un tapis de course à la maison. Je déteste voir le temps défiler. Alors j’imprime et colle sur le compteur la piste de Sotchi, en marquant “Sotchi 2014”. En cas de coup de mou, je regarde ça, et ça me remotive encore plus. Et fin 2013, Ludovic Didier, mon entraîneur, m’appelle et m’annonce ma sélection pour les étapes de Coupe du monde aux États-Unis, pendant 4 semaines. Je suis tellement heureuse. J’ai 15 ans, donc plutôt à être chez les juniors. Et après les États-Unis, on m’annonce que je pars à Sotchi. Même pas le temps de retourner au lycée !
Haute couture
SANDRINE MARTINET : J’étais super fière et honorée de porter mon premier kimono de l’équipe France. Ça touchait extrêmement mes parents aussi. Le premier vêtement France, on se dit : “Waouw !” Aujourd’hui, j’ai énormément de mal à me séparer de ces choses-là. Le kimono d’Athènes 2004, il est collector parce qu’il y a les anneaux olympiques dessus. C’est après que les agitos (symbole bleu-rouge-vert du comité paralympique, NDLR) sont apparus. J’ai rangé les kimonos dans des caisses, chez moi. À chaque fois, je ressens une certaine nostalgie quand je les touche. Ça représente l’histoire de ma carrière, le parcours, les sacrifices consentis pour en arriver là.
MARIE BOCHET : Ma première veste de l’équipe de France, c’était une Vuarnet, rouge et blanc, avec écrit “France” en énorme dans le dos. C’est costaud d’avoir le nom de son pays marqué dans le dos, nan ? Ça crée tout de suite l’appartenance au groupe et à cette nation.
TONY PARKER : Mon premier maillot, il était sale, rempli de sueur, donc je n’ai pas dormi avec quand même. (Rires.) Mais je l’ai encadré ! Il est chez moi, avec tous les autres maillots. Je les ai tous gardés.
JACKSON RICHARDSON : Il doit m’en rester encore un ou deux au fond d’une malle. À chaque fin de compétition, on pleurait toujours auprès des intendants pour en avoir un en plus, pour les garder ou les échanger. Moi, je les échangeais souvent avec mes adversaires. Mais on n’avait pas autant de jeux de maillots que les joueurs actuels, que j’envie un peu. C’était un privilège de conserver un maillot de la sélection, dans ces temps-là !
Les survêts de l’équipe de France, c’était pas le look d’aujourd’hui. Ça faisait sac à patates
CHRISTINE CARON : Je ne suis pas fétichiste, hein. Les survêts de l’équipe de France, c’était pas le look d’aujourd’hui. Ça faisait sac à patates. Pareil pour le maillot de bain qu’on m’avait fourni pour Tokyo 1964. (Rires.) On peut le voir au musée du sport, aujourd’hui. Il était en nylon, bien doublé pour surtout qu’on ne voie pas quoi que ce soit. (Rires.) Il avait une petite jupette aussi, qui alourdissait un peu dans l’eau. Mais on n’était pas obligées de le porter. On nageait avec le maillot dans lequel on se sentait le plus à l’aise.
ALEXIS HANQUINQUANT : Moi, je garde tout, notamment mes dossards, qui sont dans un placard. Je n’arrive pas à m’en défaire. Ça me fera des souvenirs pour quand je serai un vieux grincheux.
Haute couture
Par Perrine Laffont
À village découvert
JACKSON RICHARDSON : En 1992, il y avait un terrain de pétanque au village olympique de Barcelone. Tous les Français y jouaient. Ça créait des liens au sein de la délégation française. Pas que d’ailleurs. Un soir, en pleine partie avec quelques athlètes, un mec curieux avec un survêt américain, qu’on ne calculait pas trop, nous regarde l’air de dire :“Qu’est-ce qu’ils font avec leurs boules de fer, là ?” Et puis on capte : c’est Charles Barkley ! Là, on court tous dans nos chambres prendre nos appareils jetables. Eh ouais : on n’avait pas de smartphone à l’époque ! Plus tard, au réfectoire, je vois Jim Courier devant moi, avec son plateau ! Tu vois ces stars mondiales, dans le quotidien, et tu te dis : “Bah en fait, on est tous ensemble.” Dans le village, tu croises les basketteurs de 2,20 m, un haltérophile de 150 kilos, une petite gymnaste d’1,40 m… Y a de tout. C’est ça, les Jeux.
Tu vois ces stars mondiales, dans le quotidien, et tu te dis : “Bah en fait, on est tous ensemble.”
MARIE BOCHET : Personnellement, avec le planning assez chargé, t’es un peu dans une routine au village : boulot-dodo. Tu ne veux pas perturber la préparation des autres. Donc ce n’est pas la fête, qu’on faisait plutôt au club France, à célébrer les médailles des uns et des autres. Et l’avantage des sports d’hiver, c’est que c’est une petite délégation finalement. On s’encourage dès qu’on se croise.
PERRINE LAFFONT : J’ai vécu le village olympique comme une expérience hors du commun. Je croisais en vrai, au self ou ailleurs, les athlètes que je suivais habituellement sur les réseaux sociaux. J’étais tous les jours fourrée à la salle de jeux, à faire de la Wii, à jouer au Air Hockey, à prendre ma petite boisson au distributeur gratuit. J’étais comme une gamine dans un parc d’attractions. C’était juste incroyable.
La “French Touch”
ALEXIS HANQUINQUANT : Ce qui nous rassemble, c’est peut-être le côté coq français, un peu fier. Personnellement, j’ai un peu du coq en moi dans le sens où je montre peu mes émotions avant les courses. Pendant que mes adversaires cherchent des expressions sur mon visage, je suis là, comme un coq, torse bombé. C’est stratégique.
JACKSON RICHARDSON : Avant, nos adversaires aimaient bien nous regarder. Pour eux, on était folklo, le handball champagne, “vous les Français, vous pétez des durites”. On nous appelait les Barjots. La fédé pensait même, un temps, que ce surnom salissait l’image du hand français. Mais elle interprétait mal. On n’était pas des Barjots, dans l’esprit de mal faire, mais dans le sens de créer des folies qu’on ne voyait pas ailleurs. On s’exprimait de cette façon. Ce qui ne plaisait pas aux Allemands, aux Suédois ou aux Russes d’ailleurs. En plus, il y avait des Noirs dans l’équipe, dont un avec des rastas. Mais c’était ça la force de la France, ce mélange entre nos îles et la métropole. C’est ma vision, mais je crois que notre grain de folie, qui nous différencie des autres nations, vient de là.
Notre grain de folie nous différencie des autres nations
PERRINE LAFFONT : L’équipe de France de ski a la caractéristique d’être hyper soudée. Les autres nations disent de nous qu’on “a l’air d’une petite famille”. C’est le cas, on s’apprécie tous, nos caractères matchent plutôt bien, complémentaires, même si on est tous différents. Un bon équilibre. On en bave et on se soutient ensemble. Forcément, les séances d’entraînement passent mieux.
SANDRINE MARTINET : À Londres, tout le monde attendait que je gagne l’or en première journée. Blessée, j’ai ramené une médaille en plâtre. Un coup de massue sur moi et tout le judo français. Dans un état léthargique, de déception et d’injustice, je suis allée voir les autres sports. Et c’est auprès des autres athlètes tricolores, que je connaissais depuis plusieurs paralympiades, que j’ai trouvé le réconfort.
PERRINE LAFFONT : En 2014 à Sotchi, je n’arrive pas dans les 12 premières et je suis en pleurs, sur un canapé de la cabane, en bas de piste. Et Guilbaut vient me voir : “T’inquiète pas, ton heure viendra.” J’y ai forcément repensé, quatre ans plus tard, quand j’ai remporté la médaille d’or.
MARIE BOCHET : Notre équipe actuelle est en plein renouvellement, donc avec une identité en reconstruction. Mais les autres nations voyaient vraiment notre équipe précédente comme un team très convivial, chaleureux, fraternel. Quand on montait sur la boîte pour la remise des médailles, on faisait vraiment du bruit. C’est peut-être culturel ou juste parce qu’on avait des ambianceurs. Un peu des deux, sûrement. Je pense que c’est le cas dans pas mal de disciplines françaises.
Les Jeux, point d’orgue de mon parcours
JACKSON RICHARDSON : Selon moi, le sportif français doit toujours prouver, s’affirmer au regard des autres. Par exemple, au hand, on a pris des titres pendant des années et on entendait des choses comme : “Bah, ça serait bien qu’ils se cassent la gueule, pour voir ce que ça donne.” Dans les autres pays, ça n’existe pas, ça. Sans vouloir généraliser, on est parfois jaloux de la réussite de nos compatriotes. Pourtant, on doit prendre conscience de nos qualités, arrêter de dire que les autres sont meilleurs que nous. C’était ça, le hand, avant, à pêcher à l’extérieur plutôt que se concentrer sur ce qu’on avait chez nous.
TONY PARKER : Je n’ai jamais réussi à comprendre ça. (Rires.) Parfois, en France, on est trop content de voir un gars qui finit quatrième parce qu’il a fait une remontée magnifique. C’est étrange.
MARIE BOCHET : On a parfois l’impression que les Français sont des sportifs maudits. Peut-être qu’on réfléchit trop nos performances, nos pratiques. Peut-être qu’on ne lâche pas assez prise, parfois. Mais pas sûre que les équipes étrangères nous voient comme ça. Elles nous voient plutôt comme des concurrents très sérieux, qui prennent pas mal de médailles, quand même.
Adam Pretty /Allsport
“Et puis, La Marseillaise…”
JACKSON RICHARDSON : Pendant l’échauffement, je suis décontracté. Et puis, la Marseillaise... Elle a toujours compté pour moi parce que je me suis construit tout un rituel autour. C’est pendant l’hymne que je commence à ressentir la pression positive, celle qui permet de faire monter l’adrénaline. Je crée ma bulle, où sont concentrées toute mon attention et mon énergie. Je fais abstraction de tout, je ne vois même plus les spectateurs. Il n’y a que le terrain de 20 mètres sur 40, les Bleus contre l’équipe adverse. Et je suis prêt à me transcender.
CHRISTINE CARON : Je ne me souviens pas l’avoir apprise. C’était naturel. J’ai toujours été fière de dire “je suis française”, d’avoir les lettres FRANCE cousues dans le dos. Et c’était nous qui faisions cette couture, hein, à cette époque.
ALEXIS HANQUINQUANT : Une Marseillaise, pour moi, signifie que tu as gagné, bien représenté ton pays. Ça concrétise tout ce que tu as mis en place avant les entraînements, tout le travail en amont. C’est forcément super jouissif et hyper émotionnel.
Au moment du “Aux armes”, je remarque qu’il y a toujours quelqu’un qui le démarre un peu en avance, très fort et faux
MARIE BOCHET : Sur le podium, il y a tout ce cérémonial. Tu es haute, sur la plus haute marche, tu vois le public et dedans, des membres de ton équipe, ta famille. À ce moment-là, tu ressens un réel sentiment d’appartenance à une équipe, à une nation. Les Français, on est quasiment les seuls à chanter notre hymne à gorge déployée, vraiment très fort. Je me sens parfois gênée d’ailleurs, parce que c’est un hymne guerrier, à me dire : “Si les concurrentes savaient ce que veulent dire nos paroles, elles me prendraient pour une folle.” Au moment du “Aux armes”, je remarque aussi qu’il y a toujours quelqu’un qui le démarre un peu en avance, très fort et faux. Moi, je suis toujours dans le bon timing. Pour la tonalité en revanche, faut voir. (Rires.) Bref, ce “Aux armes” me met toujours un sourire au coin des lèvres. Toujours. Et puis l’émotion reprend le dessus.
Première cérémonie
Par Sandrine Martinet
Lintao Zhang/Getty Images
PERRINE LAFFONT : Quand je l’entends sur le podium de Pyeongchang, j’ai des frissons. Et heureusement que je n’avais pas un micro sur ma veste, vu comme je chante faux. Je me dis : “Ça y est, je viens de réaliser mon rêve de petite fille d’être championne olympique.” C’est du soulagement, du bonheur, de la fierté, l’accomplissement du boulot de ton staff. Un feu d’artifice, quoi…
MARIE BOCHET : Moi aussi, les frissons arrivent tout de suite. Ce moment, tu ne dois pas le contrôler, il faut laisser vivre les émotions, parce qu’elles sont super. À la limite, la seule question que je me pose, c’est : “J’ai mis mon maquillage waterproof au fait ou pas ?” (Elle éclate de rire.)
Fans, je vous aime !
SANDRINE MARTINET : À Pékin, j’avais tout un stade qui hurlait contre moi. À Rio, là, j’entendais les miens m’encourager. J’étais hyper concentrée dans mes combats, mais les trois mêmes voix ressortaient toujours : celle de mon entraîneur, de mon fils et de mon mari. Elles sont gravées en moi. Rien que d’en parler, j’en ai les larmes aux yeux. Le “Allez Maman” de mon fils, ça me rendait heureuse parce qu’il participait à sa manière à tout ça, et ça donnait de la valeur à toutes mes absences, pour l’entraînement, les compétitions.
TONY PARKER : Tous les basketteurs de ma génération sont hyper reconnaissants du soutien inconditionnel de ce public tricolore. L’Euro 2015 en France, c’était incroyable. Trente mille personnes pour du basket en France, c’était un record ! J’aurais préféré finir avec la médaille d’or, mais bon, super expérience.
ALEXIS HANQUINQUANT : Non seulement on entend bien les Français en tribunes, mais surtout, on les voit, parce qu’ils ne passent pas inaperçus, en bleu-blanc-rouge, un ou deux qui ont une casquette en forme de coq ou de poule. Ça, tu ne peux pas le louper.
Je me souviens de notre arrivée à Orly. C’était noir de monde, on m’avait même arraché des boutons de mes vêtements
CHRISTINE CARON : À mon époque, il n’y avait pas de réseaux sociaux évidemment, et je recevais des gros sacs de courrier. C’était tous les jours, pendant les Jeux de Tokyo. Des copines signaient avec moi. Juste après ces Jeux, je me souviens de notre arrivée à l’aéroport d’Orly. C’était noir de monde, on m’avait même arraché des boutons de mes vêtements. (Rires.) Mais ça ne me faisait pas peur. Sans prétention, je trouvais ça presque normal, parce que j’avais ces résultats, super jeune, et on m’a vite déroulé le tapis rouge. L’engouement ne me surprenait pas. Et mon cercle familial, Madame Berlioux, me faisaient garder les pieds sur terre.
Alexandre Loureiro/Getty Images
JACKSON RICHARDSON : J’ai toujours été reconnaissant envers les supporters. J’ai eu la chance de vivre mes rêves à Barcelone, de voir Carl Lewis, Michael Johnson, Scottie Pippen, d’échanger des autographes avec eux. Et je me suis toujours dit que je n’avais pas le droit de refuser ça. On me faisait toujours entrer en dernier, pour la présentation des équipes, parce que j’étais un des plus applaudis. Ça m’étonnait, mais ça ne me dérangeait pas. Pour moi, c’est un devoir de rendre aux supporters ce que je recevais. Si je mettais mon image en avant, c’était pour valoriser mon sport. Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que le hand m’a permis de vivre tout ça, d’avoir voyagé partout. Et de remplir le frigo.
SANDRINE MARTINET : De toute façon, être entourée, soutenue, ça change beaucoup de choses quand même. Au-delà des supporters, j’ai connu plein de judokas bridés en individuel, mais qui se transcendent en équipe. C’est le cas de mon mari par exemple. Il pouvait aller chercher des combats qu’il n’aurait jamais remportés en individuel. C’est très français ça, d’aller chercher quelque chose tous ensemble.
Edition : So Press (Ronan Boscher, Maxime Brigand, Florian Lefèvre et Mathieu Rollinger)
Création : Thalia Lahsinat